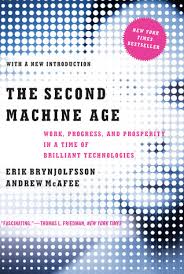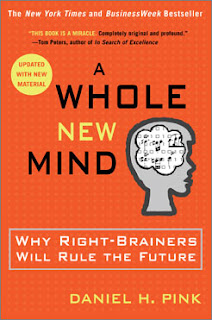1. Introduction
Le billet de
ce jour rassemble un certain nombre de réflexions autour du « futur du
travail ». Ce sujet est particulièrement d’actualité en ce moment, qu’il
s’agisse de la presse ou de la préparation de la campagne présidentielle. En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de passer une semaine à la Singularity University dans le cadre du Singularity
University Executive Program, ce qui m’a permis
d’approfondir mes idées sur le sujet. Ce billet reprend les points principaux
que j’ai développé le 12 Octobre lors du séminaire de l’Académie des
Technologies, lors d’une conférence intitulée « Emploi et travail dans un monde envahi par les robots et les
systèmes intelligents ». Il s’inscrit dans la continuité d’un premier billet écrit il y a deux ans, mais j’ai
affiné mon diagnostic et j’ai donc des convictions plus fortes et plus précises.
La première
partie fait le point sur la question de l’automatisation – des robots à
l’intelligence artificielle – et de son impact sur les emplois. Depuis la
publication du rapport de Frey-Osborne en 2012, il y a eu de nombreuses
réactions. La plupart sont conservatrices et prudentes, qu’il s’agisse du rapport de l’OCDE ou du livre récent de Luc Ferry. Je ne
partage pas ce revirement comme je vais l’exprimer, particulièrement après
avoir passé cette semaine à la Singularity
University. Je vais au contraire développer une vision de l’évolution du
travail dans laquelle l’homme est complémentaire de ces nouvelles formes
automatisées de production et de création de valeur.
La seconde
partie est une réflexion sur la société à la quelle conduit cette nouvelle
vision du travail. C’est, par construction, une contribution à l’iconomie, c’est-à-dire l’organisation de l’économie dans le cadre d’une
exploitation pleine et entière des bénéfices de la technologie de
l’information, y compris dans ces capacités d’automatisation (lire la
définition de Michel Volle). Je propose une
vision « fractale / multi-echelle » de l’ iconomie qui
réconcilie la domination des plateformes (« winners take all ») et le retour de
la « localisation » (la priorité donnée à la communauté et au
territoire ) face au désarroi (pour rester mesuré) que cette rupture de
paradigme va produire. Dans la tradition des « power laws » de la nouvelle
économie, les bassins d’opportunité créés par le progrès technologique ont une
structure maillée et multi-échelle qui contient une « longue traine »
de micro-opportunités pour microentreprises.
La troisième
partie porte sur cette rupture, la transition de phase entre le modèle actuel
de l’emploi qui est clairement à bout de souffle et un modèle possible,
correspondant à la vision développée dans les deux premières parties. C’est la
question fondamentale, et la plus difficile : même pour les partisans
d’une vision optimiste du progrès technologique dont je fais partie, la
transition qui s’annonce est complexe, voire brutale. Même si le titre du livre
de Bernard Stiegler « L’emploi est mort, vive le travail ! » contient un message positif, ce changement n’est pas moins qu’une
révolution, qui est par ailleurs déjà engagée. Face à un changement qui
s’accélère et des vagues d’automatisation nouvelles qui se dessinent, je suis
persuadé que le monde politique a un rendez-vous avec l’Histoire, et
qu’un certain nombre de mesures sont nécessaires pour éviter des scénarios
noirs qui sont fort bien décrits dans des ouvrages de science-fiction. Il est
possible de construire une société équilibrée autour de l’iconomie, mais la
tendance naturelle du techno-système, sans intervention et régulation, est
d’aller vers la polarisation et l’affrontement.
J’ai résisté
à la tentation facétieuse et opportuniste de nommer ce billet « comprendre les causes profondes de
l’élection de Donald Trump », mais je pense néanmoins qu’une des
causes essentielles de cette élection, qui semble défier le sens commun, est
qu’une grande partie des électeurs sentent plus ou moins confusément qu’un
monde est en train de se construire dans lequel ils n’ont plus de place. Ce
n’est pas une « simple » réaction à la désindustrialisation, c’est une
peur de se retrouver « assignés à résidence », pour reprendre les mots d’Emmanuel Macron, sans
utilité pour cette nouvelle société technologique et automatisée. Le défi qui
est devant nous est de rendre l’iconomie « inclusive », c’est-à-dire
avec une place pour chacun qui lui permette de contribuer au travers de son
activité.
2. Automatisation, Intelligence Artificielle et destruction d’emploi : état des lieux
2.1. Une révolution numérique qui détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée
Depuis l’étude « The Future
of Employment » de Carl B.Frey et Michael A. Osborne, qui a
annoncé que 47% des emplois seraient menacés aux US par l’automatisation, le
débat est intense. D’un côté, il existe de nombreuses études similaires, comme
par exemple celle sur le marché UK qui arrive à des résultats du même ordre de
grandeur (au UK ou aux US). D’un
autre côté, on trouve des études plus nuancées et moins pessimistes, comme celle de
l’OCDE ou celle de McKinsey. C’est ce
qui fait prendre à Luc Ferry une position plus rassurante dans son livre
« La
révolution transhumanisme ».
Je ne partage pas ce nouvel optimisme. Un des arguments est qu’une
partie des tâches, et non pas des emplois, sont touchés. Mon expérience
est que les entreprises ont acquis la capacité à redistribuer les tâches pour
transformer les gains en efficacité en réduction de coûts salariaux, en dehors
d’une hypothèse de croissance.
Ce qui me range dans le camp de
l’étude Frey-Osborne, c’est que les arguments des conservateurs reposent sur
une analyse du passé sur ce qu’on peut attendre des progrès de l’Intelligence
Artificielle. Il me semble imprudent de s’appuyer sur toutes les promesses
non-tenues des décennies précédentes pour en conclure que l’automatisation
poursuit une lente progression « as
usal ». Je vous renvoie au deuxième livre de Erik Brynjolfsson et Andrew
McAfee, « The Second
Machine Age », pour vous convaincre qu’une nouvelle vague
d’automatisation arrive à grand pas, avec une accélération spectaculaire lors
des dernières années de ce qui est possible. Les auteurs reviennent en détail
sur des avancées telles que les diagnostics médicaux par une intelligence
artificielle, les véhicules autonomes ou les robots qui écrivent des articles
pour les journaux. Pour reprendre une de
leurs citations : « Computers
and robots are acquiring our ordinary skills at an extraordinary rate”. Je viens
de passer une semaine à la Singularity
University et les exemples plus récents présentés pendant cet “executive
program” renforcent et amplifient les messages du “Second Machine Age”. Il est
assez juste de remarquer, comme le fait Erik Brynjolfson dans un de ses
exposés récents, que nous nous ne sommes pas « en
crise, mais en transformation », mais cela ne change pas grand-chose au
défi qui nous est posé. Dans ce même livre les auteurs nous disent que la
transformation produite par la technologie est bénéfique … mais pose des
« défis
épineux ».
Les usines « sans humains » sont
déjà là, les exemples sont multiples, de différentes tailles et dans différents
domaines. L’exemple de l’usine de Sharp pour produire des dalles LCD, que j’ai
pu visiter personnellement, est spectaculaire : moins de 20 personnes pour
plus d’un kilomètre carré d’usine, cette visite, qui date déjà de plusieurs
années, m’a profondément marquée. L’exemple de l’usine de fabrication de Tesla
est non moins exemplaire, à la fois par le choix de la relocalisation et
l’automatisation la plus poussée possible. Le cas de l’usine de Sélestat du
groupe SALM est un peu moins spectaculaire, mais tout
aussi instructif. Le fait que le
monde change aussi vite sous nos yeux doit d’ailleurs nous conduire à beaucoup
de prudence sur les études que je viens de citer. Comme le remarque Neil Jacobstein, que j’ai
eu le plaisir d’écouter sur ce sujet à la Singularity
University, ces études s’appuient sur une continuité des types de tâches à
effectuer (ce qui permet d’appliquer le peigne de l’analyse de la future
capacité à automatiser), une sorte de « everything being equal », qui est probablement valide sur une
courte échelle (quelques années) mais beaucoup plus discutable sur quelques décennies.
2.2. Il va falloir du temps pour remplacer complètement les humains dans les processus
Comme je le remarquais dans mon billet précédent, la route vers l’automatisation n’est pas simple. Les annonces célèbres de Foxcon qui voulait remplacer ses 300 000 employés par un million de robots n’ont pas été suivies d’effets notables pour l’instant. En revanche, l’automatisation des entrepôts d’Amazon avec des robot KIVA est une réalité, tout comme celle des usines « sans humains » que nous avons mentionnées. Cette réalité contrastée s’explique par le fait que l’automatisation des tâches non répétitives reste complexe. Plus précisément, les progrès en apprentissage – en particulier le deep learning – sont spectaculaires lorsque la question à résoudre est précise et lorsqu’il existe beaucoup de données pour apprendre. En revanche, s’il y a peu de données (s’il faut extrapoler sur peu de faits, le « sens commun » devient fondamental et cela reste un sujet difficile) et surtout si l’objectif est mal défini (et encore plus lorsqu’il s’agit de définir ses propres objectifs), l’être humain conserve pour quelques temps un avantage sur la machine. Ceci conduit à un article récent de McKinsey intitulé « Where machines could replace humans—and where they can’t (yet) » qui aboutit au même ordre de grandeur sur ce qui est substituable et ce qui ne l’est pas. Pour comprendre ce qui est déjà possible et ce qui ne l’est pas encore, je vous recommande « What Artificial Intelligence Can and Can’t Do Right Now » de Andrew Ng. Mais les limites d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain !
Une des conséquences de l’état de
l’art en IA est que l’automatisation des emplois peut commencer par des emplois
d’experts et non de généralistes. C’est ce
qu’expliquent Brynjolfson et McAffe : « As the cognitive scientist Steven Pinker puts it, “The main lesson of thirty-five
years of AI research is that the hard problems are easy and the easy problems
are hard. . . . As the new generation of intelligent devices appears, it will
be the stock analysts and petrochemical engineers and parole board members who
are in danger of being replaced by machines. The gardeners, receptionists, and
cooks are secure in their jobs for decades to come.” C’est précisément ce qui m’a frappé
pendant ma semaine à la Singularity
University : les exemples abondent de domaines pour lesquels l’algorithme
fait mieux que l’humain, mais ce sont précisément des domaines d’experts avec
une question bien définie (quel portefeuille d’investissement construire, quel
diagnostic sur une tumeur possiblement cancéreuse, …) et une très grande
volumétrie de données disponibles. Grace au groupe de travail de l’Académie des
Technologies qui poursuit son enquête sur les avancées “récentes” de l’IA et de
l’apprentissage, ma conviction se conforte que, même si la date est incertaine,
la tendance à l’automatisation des emplois du rapport Frey-Osborne est la
bonne.
Cette notion d’automatisation des
emplois est un raccourci qui est probablement trompeur, dans le sens que plutôt
d’avoir des robots et des logiciels d’intelligence artificielle qui vont
remplacer des humains un par un, c’est
l’environnement complet qui devient “intelligent”. La combinaison de robots,
d’objets connectés, de senseurs, et de logiciels “intelligents” ubiquitaires
(répartis depuis le cloud jusque dans l’ensemble des processeurs invisibles qui
nous entourent) crée l’environnement de travail “assisté” dans lequel moins
d’humains réalisent plus de choses, mieux et plus vite. L’article de McKinsey, « Four
fundamentals of workplace automation » explique que « Jobs
will be redefined before they are eliminated » et insiste sur cette
transformation progressive des activités dans ce nouvel environment. Cette
transformation par l’automatisation ubiquitaire est plus “douce”, mais elle
n’en est pas moins disruptive.
2.3. Transformation du paysage de l’emploi
Dans le précédent billet j’ai déjà
cité abondamment l’article de Susan Lund, James Manyika et Sree Ramaswamy,
intitulé « Preparing for a new
era of work » (Kc Kinsey
Global Institute), qui me semble profondément pertinent. Pour simplifier voire
caricaturer, il propose de séparer les emplois en trois catégories : la production, les transactions et les interactions.
Les deux premières catégories sont celles qui vont être massivement touchées
par l’automatisation : les emplois de production sont – dans leur grande
majorité – remplacé par des robots tandis que les emplois liés aux transactions
vont être décimés par l’utilisation de l’intelligence artificielle, même si cela
prendra un peu plus de temps – cf.la section précédente. Il reste, pour un
temps plus long, le domaine des métiers d’interaction qui peut résister plus
longtemps. Ce mot « interaction » serait complexe à définir puisqu’il
fait référence aux interactions entre humains et s’oppose à la catégorie
précédente par un contenu « non-transactionnel » sur un registre
émotionnel (il y a une certaine circularité dans l’argument, et des
spécialistes de robotique m’ont fait remarquer que de nombreux robots ont
précisément un objectif d’interaction, y compris avec des humains). Je trouve
néanmoins cette distinction intéressante, et je suis plutôt d’accord avec la
proposition des auteurs. Les emplois de demain seront très probablement
caractérisés par les échanges entre humain dans des dimensions émotionnelles,
affectives, artistiques qui dépasseront le cadre de l’automatisation tout en
profitant de ce nouvel « environnement intelligent ». Par exemple, le
jardinier, le masseur ou le plombier de demain seront des métiers technologiques,
collaboratifs et sociaux, dans le sens ou l’environnement intelligent déchargera
de certaines activités pour se concentrer sur l’essentiel (par exemple, le sens
et le plaisir du jardin).
Dans cet univers qui se dessine, tout
ce qui s’automatise devient une commodité, la valeur perçue se trouve dans les
émotions et les interactions. C’est précisément une des thèses du best-seller déjà
ancien de Daniel Pink, « A Whole New Mind », qui caractérise
les métiers de demain par une « prévalence du cerveau droit sur le cerveau
gauche » - à ne pas prendre au pied de la lettre mais dans le sens communément
admis même si discutable. On
retrouve dans son livre les talents de demain comme le
« story telling », le
« design », la
« créativité », l’empathie ou le jeu. Ces métiers d’interaction de
demain ne sont pas issus de nouveaux domaines à créer, mais pour leur grande
majorité la continuité des métiers d’interaction d’aujourd’hui. Santé, bien-être, ordre public, éducation et
distraction vont continuer à être les principaux fournisseurs de travail pour
les décennies à venir.
Le jardinier du futur utilise probablement
un ou plusieurs robots, mais il vend une « expérience » - dans le
sens où il raconte une histoire. Ce jardinier n’est pas forcément isolé, il
peut profiter d’une communauté qui lui fournit du contenu – une éducation
permanente – qui lui permet de vous toucher en faisant le lien entre votre
jardin et vos vacances. Il peut également profiter d’une plateforme
technologique qui lui fournit les robots autonomes qui vont tondre la pelouse
ou tailler la haie. Il est probable également que ce jardinier
« programme » le système (jardin + robots + environnement) avec la
parole. Pour reprendre une citation d’un des membres de Singularity University :
« We won’t program computers we’ll
train them like dogs”. Je crois
beaucoup plus à cette vision qu’à la théorie selon laquelle nous aurons des
ordinateurs tellement intelligents que cela signifierait la fin de la programmation. Ce qui
est sûr, c’est que le sens de “programmer” et de qu’est le “code” va évoluer,
mais l’activité de programmation d’expérience va au contraire se développer de
plus en plus au fur et à mesure que l’environnement devient intelligent. Le
robot que le jardiner va utiliser sera connecté et le dialogue avec le
jardinier sera plus riche qu’une simple séquence d’opérations contextuelles.
Pour rester dans la veine du Clue Train
Manisfesto, je propose l’aphorisme suivant pour représenter la programmation
de demain : « experiences are grown from conversations ».
3. Iconomie: Vision cible positive d’une société très fortement automatisée
3.1. Un maillage de plateformes et de micro-entreprises
Ma vision du paysage de l’emploi est un réseau multi-échelle maillé de
structures de toutes tailles, depuis les grandes entreprises multinationales
d’aujourd’hui jusqu’aux autoentrepreneurs, dans lequel le mouvement de
polarisation (consolidation des grandes plateformes et multiplication des
pico-entreprises) se poursuit et s’amplifie. Le point de départ de mon
raisonnement est que nous aurons toujours des entreprises dans 20 ou 30 ans, et
que le phénomène d’ubérisation du travail n’aura pas dissout le concept de
l’entreprise. Je n’y reviens pas, j’ai traité en détail ce sujet dans mon
billet précédent. Pour résumer, la complexité croissante du monde exige le
travail synchrone, ce que remarquent tous les auteurs de la Silicon Valley,
d’Eric Ries à Eric Schmitt. Ce sujet fait débat, ma position consiste à dire que les coûts de
transaction, pour reprendre l’analyse de Coase et Williamson, reste minimisé lorsque les équipes cross-fonctionnelles modernes de développement
produit sont co-localisées,
synchronisées par des rituels et une vision « incarnée » commune et
unifiée par un ensemble de techniques qui font des lieux un espace collaboratif
(le « visual management » étant un exemple). L’évolution des
technologies de communication (de la téléprésence à Hololens) déplace les frontières de ce qui est possible à distance en « mode
plateforme », mais le même progrès technologique renforce le potentiel de
l’environnement intelligent comme outil collaboratif.
La mondialisation et la numérisation conduisent à la concentration. Ceci
est très bien expliqué par les penseurs de l’iconomie comme Michel Volle. Les
raisons sont multiples et profondes. L’économie numérique est principalement
une économie de coûts fixes, ce qui favorise l’économie d’échelle. Bien plus
important encore, les effets de réseaux – en particulier dans les marchés biface et dans le développement d’écosystèmes autour de plateformes - et les
lois de réseau de type Metcalfe donnent un avantage important au plus gros joueur (souvent le premier
mais pas forcément). Je vous renvoie à l’analyse de la valeur des réseaux sociaux pour voir un exemple ou les équations de
renforcement de la position dominante sont encore plus forte que la loi de
Metcalfe. Dans le livre de
Brynjolfson et McAffee, on lit: “Each time a market becomes more digital,
these winner-take-all economics become a little more compelling”. Cette concentration ne produit pas plus
d’emplois, d’autant plus qu’elle est nourrie par l’augmentation exponentielle
des capacités technologiques et par l’automatisation que nous venons d’évoquer
dans la partie précédente.
Heureusement, la concentration des plateformes conduit également à la
croissance des écosystèmes qui leur sont associés, ce qui peut créer des
opportunités pour une multiplicité d’acteurs locaux, tout comme un arbre qui
grandit porte plus de feuilles. Cette croissance de la « frontière »
peut poser question – elle peut sembler marquée par un optimisme technophile naïf
-, mais elle est nourrie par l’explosion exponentielles des capacités
technologiques et sur la tendance de fond (qui est liée à cette explosion) de
mieux servir les individus (le mythique « segment of one ») et
les communautés. Le second point va être développé dans le reste de cette
deuxième partie, revenons donc sur le premier. Prenons justement l’exemple des
capacités d’Intelligence Artificielle développées et exposées par Google (cf. TensorFlow). Il est plus que probable que si cette démarche est couronnée de
succès, elle va contribuer à la croissance forte de Google. Mais elle va
également ouvrir des champs possibles à un rythme supérieur que ce que Google
peut produire, ce qui signifie qu’une partie encore plus importante de valeur
va apparaitre « à la frontière », lorsque d’autres acteurs vont
utiliser ces technologies mise à disposition par Google pour résoudre d’autres
problèmes que ceux qui intéressent Google. On voit la même chose avec la
croissance d’iOS comme plateforme mobile : au fur et à mesure que les
capacités sont ajoutées dans la plateforme de développement de l’iPhone – on
pense ici bien sûr à Siri – le domaine fonctionnel rendu possible à la
communauté des applications mobiles augmente plus vite que ce qu’Apple en
retire pour ses propres fonctions.
3.2. Economie Quaternaire et services à la personne
L’économie quaternaire, un concept que
nous devons en particulier à Michelle Debonneuil, propose une
extension des trois secteurs traditionnels – primaire pour les matières premières, secondaire
pour la fabrication et tertiaire pour les services - à un nouveau domaine dont
les produits ne sont ni des biens, ni des services, mais « de nouveaux services
incorporant des biens, la mise à disposition temporaire de biens, de personnes,
ou de combinaisons de biens et de personnes ». L’évolution vers
l’économie quaternaire est fort logiquement liée, comme le souligne Michelle
Debonneuil, aux progrès des TIC qui permettent d’apporter des services véritablement
personnalisés sur le lieu précis où ils sont nécessaires, y compris dans
gestions des femmes et des hommes qui rendent ces services de façon courte et
ponctuelle. Le développement de l’économie quaternaire est indissociable du
domaine des « services à la personne », dont l’essor est
l’aboutissement naturel d’une société post-industrielle. Cet essor est fort
logiquement accéléré par l’automatisation telle que décrite dans la première
partie puisque ces « services à la personne » sont les domaines dans
lesquels les humains peuvent exercer une supériorité sur la machine.
Ces domaines
sont fort nombreux et peuvent, sous certaines conditions, permettre la pleine
occupation, sinon le plein emploi, de la population déplacée par
l’automatisation. Listons les plus évidents : l’alimentation (dans sa
phase « finale » de service à la personne, de la cuisine au
restaurant), l’habillement, l’aménagement des habitations, la médecine, le
bien-être, l’éducation et la culture, la distraction, l’art, etc. Pour la
plupart de ces domaines, le 20e siècle a été un siècle
d’industrialisation et d’orientation vers les produits. L’économie quaternaire
remet le client au centre de l’expérience et s’intéresse plus au service reçu
et perçu qu’aux produits sous-jacents. C’est cette remise au centre de
l’interaction entre l’utilisateur et le fournisseur qui permet de
« réinventer » des métiers de services à la personne. Cette analyse est partagée
par Erik Brynjolfson et Andrew McAffee qui écrivent: « Results like these indicate that cooks, gardeners, repairmen,
carpenters, dentists, and home health aides are not about to be replaced by
machines in the short term ».
On pourrait
me faire remarquer que cette vision de l’emploi en 2030, qui recoupe fortement
des domaines de « service publics », conduit plutôt à l’augmentation
du nombre de « fonctionnaires » qu’à leur diminution. Si le terme de
fonctionnaire désigne de façon très large une personne financée par la
collectivité, c’est probablement exact. Cela ne signifie pas que le nombre de
personne ayant le statut de fonctionnaire doive augmenter, ni que le budget
correspondant doive faire de même (ce qui semble clairement impossible de toute
façon). Il a de nombreuses façons de contourner ce paradoxe, par exemple en
appliquant à l’Etat les principes de l’Entreprise 3.0 pour réduire le poids de l’appareil de
contrôle par rapport à l’appareil opérationnel. Ce n’est pas utopique, il
existe de multiples exemples d’application des nouvelles structures de
management dans les services publics dans d’autres pays. On peut
également penser que les nouveaux modes de travail que nous allons continuer à
décrire s’appliquent parfaitement à un grand nombre de services publics, à
l’exception d’un tout petit nombre de fonctions régaliennes. Je pourrais
pousser la malice à faire l’hypothèse que le déséquilibre du budget de l’Etat
vient du trop grand nombre de personnes « payées pour leur cerveau
gauche » (une autre façon de parler de ceux qui analysent et contrôlent au
lieu de faire). Enfin, le grand mouvement de l’automatisation des fonctions
transactionnelles évoqué dans la première partie offre une possibilité à l’Etat
de redistribuer ces économies de fonctionnement vers des rôles d’interaction et
de lien social.
3.3.
L’artisanat et la personnalisation de masse
Je reviens ici sur une idée profonde de Avi Reichental - dont j’ai déjà recommandé l’exposé TED - : La production de masse est une parenthèse historique, et nous allons pouvoir revenir au confort du sur-mesure dans de nombreux domaines grâce aux progrès de la technologie, en particulier l’impression 3D. Avi Reichental illustre cette idée sur le principe d’une chaussure qui combine l’impression 3D d’une semelle uniquement adaptée à la bio-morphologie de l’utilisateur avec l’assemblage/fabrication locale. La personnalisation de masse est due à la fois au progrès technologique (numérisation de la conception, impression 3D, automatisation de l’assemblage, …) qui fait émerger des plateformes mise à disposition du plus grand nombre, et le besoin de retrouver une expérience sociale de proximité. Il n’y a donc pas que l’approche technologique : un certain nombre de métiers d’artisanat d’art pourraient redevenir pertinents.
L’idée que nous
allons tous vivre de notre créativité tandis que les machines s’occuperont de
la production est naïve et probablement fausse. Le tissu de multinationales
évoqué dans la première partie a besoin de nouveaux talents, et en particulier
de créatifs et de designers, mais dans un petit nombre par rapport aux laissés
pour compte de l’automatisation. En revanche, le monde « frontière »
des opportunités de services, qu’il s’agisse d’adaptation au besoin d’une
communauté ou d’un individu, ou encore d’accompagnement et de mise en scène – par exemple, l’art de la parole a toujours été
associé à la vente de vêtements - a une structure beaucoup plus riche et
étendue que l’on pourrait qualifier de « fractale » ou de « multi-échelle ».
Dans ce monde de l’interaction, il existe des opportunités à différents niveaux
de talents, qui peuvent coexister. Le service d’interaction se déplace
difficilement (en tout cas avec un coût) contrairement à une expérience
digitale. Un service moyen fourni par un talent médiocre peut coexister avec un
service plus élaboré. Les « artisans de la personnalisation » de
masse peuvent opérer sur des échelles géographiques différentes selon leur
talent, dessinant une « power law » des bassins de chalandise. Cette
coexistence ouvre la voie, surtout avec le support économique de l’état sur
lequel nous allons revenir, à un marché abondant de services à la personne de
toutes sorte. Cette renaissance de « l’artisan de proximité » risque
de se trouver facilité par une pression communautaire – que l’on commence déjà à voir à l’œuvre - et une
priorisation de ce qui est local sur ce qui est global, en contre-réaction à la
mondialisation.
Cette
personnalisation des services à la personne est donc une double conséquence du
progrès technologique : à la fois parce que le monde numérique facilite la
personnalisation (dimension technique) mais aussi parce que la transformation
due à l’automatisation (première partie) va rendre les services personnalisés
d’interaction à la fois nécessaires et accessibles (nous reviendrons sur la
dimension économique dans la dernière partie).
Si l’on applique cette idée de la personnalisation de masse à l’ensemble
des domaines de services de la section précédente, on voit émerger ce qu’on
pourrait qualifier de démocratisation de « privilèges aristocratiques du
19e siècle ». Non seulement l’accès aux vêtements, aux meubles
sur mesure pourrait redevenir courant (ce qui était le cas il y a un siècle),
mais les services d’un cuisinier, d’un tuteur, d’un coiffeur ou d’un masseur à
domicile pourraient se démocratiser. De façon plus spectaculaire, la
contribution d’un revenu universel pourrait permettre de rendre les métiers et
les œuvres d’art accessible à (presque) tous. Dans un système économique qui permet
à chacun de disposer d’un premier niveau de revenu garanti, il est possible à
un beaucoup plus grand nombre d’artistes amateurs de vivre de leur art, et donc
de permettre de la sorte à des citoyens ordinaires d’avoir le plaisir de
posséder un tableau – par exemple – unique.
4. Les défis de la transition : accompagner le choc d’un changement de civilisation
4.1 La menace des robots de compagnie anthropomorphes
L’essor de la robotique au Japon montre que l’interaction émotionnelle avec des humains n’est pas un champ exclu aux robots. En fait ce domaine n’est pas particulièrement complexe, il n’est pas très difficile de donner des émotions aux robots et aux programmes – c’est un champ de recherche et d’expérimentation en plein essor - et il est encore moins difficile d’apprendre aux programmes à « lire nos émotions ». Comprendre nos émotions à partir d’un signal sonore (notre voix) ou visuel (la vidéo de notre visage) est un exemple type de problème de reconnaissance que nous avons évoqué dans la première partie, avec des réponses claires et des milliards d’exemple. Ce n’est pas une surprise de constater que le deep learning donne déjà d’excellent résultats, que chacun peut tester grâce à des API ouvertes (ou en téléchargeant « Moodies » sur son smartphone). Pire encore, il est très facile de tromper nos neurones miroirs avec des têtes artificielles qui s’adaptent à nos expressions faciales. J’en ai fait l’expérience surréaliste avec une tête artificielle fort simple il y a déjà 10 ans dans un laboratoire IBM. Pour résumer, il ne faut pas considérer que le domaine « emploi d’interaction » est hors de portée des progrès de l’automatisation.
En revanche, il y a un enjeu majeur de
société car l’automatisation de l’interaction n’est pas un progrès en soi.
Contrairement à la production et aux transactions, les gains en vitesse et
précision qui sont souvent les objectifs de l’automatisation ne sont pas des
enjeux majeurs. Il y a donc plus de liberté pour faire de l’automatisation un
choix de société. L’enjeu est tout simplement d’accompagner une transformation
plus harmonieuse vers l’iconomie en conservant pour de nombreuses décennies la
primauté de l’humain dans les métiers de l’interaction. Si la société laisse le
domaine de l’interaction être envahi par la robotisation, nous allons au-devant
d’une véritable crise. Laissés à la loi du marché et du possible technologique,
ces robots vont apparaitre et nous obtiendrons dans le meilleur des cas une
société à deux vitesses et une multitude
d’exclus. Dans le pire des cas, les tensions sociales seront
insupportables et cela nous conduira à la guerre civile. Le Japon est un cas
particulier car il y a un fort déficit démographique à cause du vieillissement
de la population, mais de façon générale et simplifiée, il faut réserver les métiers
d’interaction aux humains déplacés des fonctions de production et de
transaction.
De fait, étant plutôt optimiste de
nature, je pense que les pays démocratiques se protégeront en réglementant
l’utilisation de robots humanoïdes. Cette réglementation n’est pas forcément
une simple interdiction, cela peut être une forme de taxation qui permet à
l’humain de rester compétitif par rapport à la machine. Il y a probablement un
équilibre entre une pression sociale de conserver des humains dans ces emplois
– et on peut s’attendre à des réactions violentes face aux robots s’ils sont
introduits dans des « customer-facing
jobs » dans une société en crise du travail –, une fiscalité du
travail qui reconnait l’interaction et la substitution de la machine par
l’homme, et la réduction du coût du travail humain au moyen du revenu universel
sur lequel je reviens dans la section suivante. Ce scénario de contrôle de
l’utilisation de robots humanoïdes n’est ni simple ni tranquille, la protection
qui sera réclamée par la population face à l’automatisation des fonctions de
production et de transaction peut prendre des formes de protestations régressives,
allant jusqu’à des surprises importantes lors d’élections J Au risque de me répéter, vouloir
freiner les robots humanoïdes n’est pas un jugement technologique (le
développement de ce type de robots est non seulement possible, il est
inévitable), ni moral (il n’y a rien de répréhensible en soi à vouloir créer
des machines avec lesquelles il est plus facile de communiquer car elles nous
ressemblent) mais systémique. Il ne s’agit que d’un réglage de vitesse de flux,
au sein d’un écosystème avec des activités qui disparaissent et apparaissent,
mais qui me semble essentiel. Il faut se donner le temps sur plusieurs
générations pour absorber les transformations que la technologie va rendre
possible. Notons également qu’il est quasi-impossible de lutter contre
l’automatisation des fonctions de production et de transaction dans une
économie mondialisée (il y aura toujours un acteur quelque part pour tirer le
meilleur parti économique de la technologie), tandis que l’activité
d’interaction n’est pas dé-localisable par définition et reste donc sous la
juridiction économique des états.
4.2.
Un revenu universel pour permettre à chacun d’exister
Le revenu
universel – ou revenu de base, en suivant l’expression anglaise « Universal Basic Income » - apparait naturellement comme solution pour faciliter la
transition vers l’iconomie. Un des spécialistes mondiaux du sujet, Guy Standing, a introduit le
revenu universel pour éviter le « précariat » qui est précisément la condition des homme déclassés dans une société qui
n’a plus besoin de leur activité : « [precariat] specifically,
is the condition of lack of job
security,
including intermittent employment or underemployment and the resultant precarious existence ».
Le revenu universel consiste à garantir à chacun un niveau minimum de
ressources, sans conditions, pour permettre à tous de vivre dignement. Il est
souvent présenté, comme par exemple par Gaspard Koenig qui est
un des spécialistes français, comme un « nouveau
droit de l’homme ». Je vous renvoie au site « Génération
libre » pour plus de détails sur LIBER. Le sujet
du revenu universel s’est d’ailleurs invité fort logiquement dans la campagne
politique, avec des prises de positions de Benoit Hamon et de Nathalie Kosciusko-Morizet, ainsi que de notre
premier ministre. En
suivant les pas de Guy Standing, ces femmes et hommes politiques constatent
l’éclatement du marché du travail – sur lequel nous reviendrons dans la
prochaine section-, la désindustrialisation et la création de laissés pour
compte par une vague d’automatisation qui ne fait que s’amplifier. Le revenu
universel est donc un premier réflexe de protection par la solidarité, ainsi,
dans le cas de la France, une remise à plat d’un système de protection sociale
complexe qui contient déjà les germes d’un revenu universel de base.
D’un point de vue systémique,
l’objectif du revenu universel n’est pas de permettre l’oisiveté
pour tous, mais de déplacer les contraintes de rentabilité des activités
humaines. Très logiquement, c’est une façon de redonner au travail humain un
peu de compétitivité vis-à-vis de celui de la machine. Il est donc logique de
penser au revenu universel pour lutter contre les effets indésirables d’une
automatisation trop rapide. De fait, l’objectif du revenu universel est de
déplacer « une barrière de potentiel » pour permettre au plus grand
nombre d’accéder et de réussir
dans un statut d’entrepreneur.
Cette idée de « barrière de
potentiel » est une métaphore qui illustre le fait qu’il existe des
multiples opportunités de travail – en particulier dans les services à la
personne pour tous – mais nous n’avons pas tous le talent d’en faire une
activité rentable économiquement. Le revenu universel « déplace la
barrière de potentiel » dans le sens où il permet à un plus grand nombre
d’autoentrepreneurs de produire un complément de revenu à partir de leurs
talents, à la fois en diminuant la prise de risque et le volume d’affaire à
générer pour que l’autoentreprise soit viable. Cette position qui voit le
revenu universel non pas comme une nouvelle forme d’assistance mais comme un
démultiplicateur est l’objet de nombreux débats voire de
nombreuses critiques. Je reste
cependant convaincu qu’il y a une véritable adéquation avec le concept de la
distribution « multi-échelle » (ou de « power law ») des talents et des opportunités, évoqué dans la
deuxième partie. Autrement dit, pour que le « gisement des services à la
personne » représente un « bassin d’activité suffisamment
vaste » pour offrir du travail à la majorité des citoyens, il faut un
modèle économique qui permette de vivre dès que le service fonctionne sur une
micro-communauté, ce qui est rendu possible par le revenu de base universel. Je
conjecture que la structure cible des services à la personne dans une iconomie
de pleine activité est une structure de petits mondes au sens de Duncan Watts
(ce qui nous renvoie à des billets très
anciens de ce blog).
En effet, il ne s’agit pas d’assurer
« simplement » à chacun un revenu de base, mais véritablement une
opportunité de « Universal Inclusive Contribution » - pour
faire le parallèle avec le concept original de « Universal Basic Income » : permettre à chacun de contribuer à
la collectivité, de trouver sa « place » par un travail qui contribue
à la société, ce que permet le modèle fractal des services d’interaction.
Autrement dit, le revenu universel doit être l’opposé de l’assignement à
résidence dont parle Emmanuel Macron, sans être non plus un travail
« bénévole forcé ». Lors de mon intervention du 12 Octobre, je me
suis permis d’utiliser l’image du statut « d’intermittent
du spectacle » pour tous J Le débat en
France autour de ce statut fait que cet emprunt n’est probablement pas
judicieux, mais il y pourtant dans ce statut de nombreux points positifs puisqu’il
joue précisément, avec succès, un rôle
incitatif en fournissant un complément de revenu. Ce statut permet d’avoir
une population active employées dans les métiers du spectacle qui est nettement
supérieure à ce que la loi du marché produirait (une autre forme de
« déplacement de barrière de potentiel »). Il y a aujourd’hui environ
un million
d’auto-entrepreneurs, il faut créer les conditions pour une
augmentation de presque un ordre de grandeur. Je n’ai pas de « boule de
cristal », mais il me semble clair que la répartition des statuts entre
employés, « freelance » (cf. la section suivante) et autoentrepreneurs
va devenir beaucoup plus équilibrée en 2030 qu’elle ne l’est aujourd’hui.
4.3. Fin de l’emploi, vive le travail ! Un nouveau contrat social
La
diminution des emplois salariés a déjà commencé. J’emprunte le titre de cette
dernière section au livre de Bernard
Stiegler. L’exemple du « cuisinier à
domicile » permet de comprendre ce concept un peu théorique de
« talent multi-échelle ». Le cuisinier médiocre est condamné à ne faire
souffrir que ses proches de son absence de talents, mais celui qui a un petit
talent peut l’exercer dans son voisinage proche (par exemple son immeuble)
comme un service de proximité – pour dépanner. L’échelle suivante, d’autoentrepreneur
non rentable est de procurer ses services dans son quartier. Plus le domaine
grandit, plus on se rapproche d’un véritable statut d’artisan-entrepreneur. Un
talent reconnu à l’échelle d’une ville permet de créer une entreprise traditionnelle,
et on passe ensuite dans le domaine du professionnel reconnu. Compte-tenu du
niveau de vie des Français, il y a peu d’emplois de cuisinier à domicile – même
si l’on introduit des plateformes d’intermédiation de type Uber – mais si l’on
regarde les opportunités créées par les vies complexes des salariés, il y a
beaucoup de travail. C’est l’enjeu du modèle « intermittent du service à
la personne ».
S’il est
possible de fournir un travail pour tous, il semble en revanche probable que le
modèle économique que je viens d’esquisser s’accompagne d’une décroissance des
emplois, ce qui est la thèse du livre de Stiegler. Thierry Breton lors de son intervention
pendant le même séminaire du 12 Octobre nous a parlé de la « Gig economy ». Le président d’ATOS
constate qu’un nombre croissant des jeunes recrutés ne souhaitent plus un
emploi salarié et préfère la liberté d’un mode « freelance ». Pendant
la semaine à la Singularity University,
j’ai entendu le même message : le « freelance » représente déjà
35% de la force de travail en 2015 et les spécialistes prévoient 50% en 2020. Cette
transformation illustre la complexité et la richesse des entreprises qui
combinent la force des « liens forts » – des noyaux de permanents
unis par les valeurs de la marque – et des « liens faibles » –
l’appel à la richesse encore plus grande des talents extérieurs à l’entreprise.
J’utilise ici bien évidemment l’appellation de liens forts et faible en référence
à la sociologie, un emprunt que j’ai
fait de nombreuses fois.
Il ne faut
pas se crisper sur cette dualité des statuts : elle correspond à des
aspirations différentes pour ceux qui travaille et à un besoin des nouvelles
formes d’entreprises. Dans le best-seller « Exponential Organizations », les
auteurs décrivent l’organisation idéale, celle qui permet de s’adapter aux flux
continu du changement exponentiel des technologies, avec des modes de travail
qui reflètent une partie des idées exprimées ici. Nathaniel Calhoun a reconnu pendant
cette semaine à la Singularity University
que ce nouveau mode d’organisation crée une contrainte sur les employés: « Exponential Organizations
worsens the fate of labor ». Les auteurs de « Exponential
Organizations » proposent
l’acronyme SCALE qui signifie : "Staff" à la demande,
Communautés, Algorithmes, effet de Levier sur les ressources et Engagement.
IDEAS reflète les principes fondateurs : Interfaces (pour attirer les
contributions externes), Dashboards (pour décider à partir des
mesures), Expérimentation, Autonomie et Social (Enterprise 2.0). Ces nouveaux
modes d’organisation sont des leviers d’adaptabilité et de flexibilité, mais je
rejoins Luc Ferry lorsqu’il souligne le besoin de régulation à cause de la
brutalité du capitalisme à l’œuvre dans la révolution digitale (depuis les
conditions Uber/Amazon jusqu’aux politiques d’évasion fiscale des GAFAs).
Pour
conclure, il convient de souligner que ce nouveau mode de vie, en dehors du
statut « traditionnel » de salarié, peut être aspirationnel. Le travail de cuisinier à domicile est un
travail noble, qui demande un goût de l’interaction avec les personnes en
permettant de nourrir sa passion pour l’art culinaire. En revanche, une telle
transformation de la société et de la culture représente un défi formidable
qu’il faut accompagner. La réalisation de soi à travers une position salariée
dans une entreprise, même si elle est récente dans l’histoire de l’humanité, a
suffisamment marqué les dernières générations pour que l’adoption d’un modèle
différent soit une révolution. Il y a de multiples éléments favorables. Comme
l’a souligné Joël de Rosnay, les jeunes portent un regard différent que celui
de leurs aînés sur le travail. Ils sont volontiers des « slashers », à la recherche de
la passion et des interactions dans leurs activités professionnelles. Ils sont
plus à la recherche de projets qui se renouvellent fréquemment (ce qui nourrit
la « gig economy ») et vivent plus confortablement
que les générations précédentes l’intrication entre la vie personnelle et la
vie professionnelle. Néanmoins, à l’échelle de la société, cette évolution doit
être accompagnée par la formation et l’éducation. Je termine en vous renvoyant
à Michel Volle que j’avais déjà cité dans mon billet précédent : cette nouvelle
économie des microentreprises et des services à la personne nécessite une revalorisation
des compétences gestuelles et relationnelles.